• CHRONOTOXICITE PLUS FAIBLE LE MATINCAR INDEX MITOTIQUE LE PLUS FAIBLE
– Radio toxicité plus faible le matin
-- Chimiothérapie
• Définition= heure optimale d’administration d’un agent thérapeutique de manière à en augmenter les effets désirés et/ou la tolérance.
Schéma thérapeutique fondé sur la prise en compte d’un rythme biologique
DIFFERENTES PHASES D’ETUDE
• PREREQUIS
– Connaissances nécessaires avant d’entreprendre une
étude chronopharmacologique prospective :
rythme des pathologies concernées par le médicament (ex.:asthme)
– Évaluation rétrospective du facteur temps dans les essais cliniques
concernant le médicament
– Étude pharmacologiques: animal, in vitro…
• PHASE 1: homme sain ou cancéreux ou sidéen
– Étude de la chrono cinétique et la chrono tolérance à chrono modulation
du débit de perfusion
PHASE 2: chrono efficacité chez malade
PHASE 3: essai multicentrique randomisé
Comparaison entre perfusion constante et chrono modulée
dans une pathologie donnée
RESULTATS D’UNE ETUDE SUR LE K COLORECTAL
• L’ASSOCIATION 5-FU-AF-L-OHP A MONTRE UNE EFFICACITE ANTI-TUMORALE DE 20% > DANS LA MODALITE CHRONOMODULEE PAR RAPPORT A LA MODALITE CONSTANTE AVEC 6X MOINS DE COMPLICATIONS A TYPE DE MUCITES SEVERES ET 2X MOINS DE NEUROPATHIES SENSITIVES (PR LEVI ET COLL. 1994)
Essais cliniques effectués pour permettre et valider la chronothérapie par 5-FU-AF-L-OHP dans les cancers colorectaux métastatiques
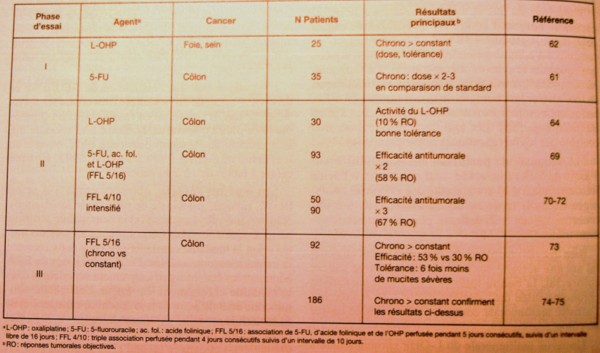
L-OHP: oxaliplastine; 5-FU: 5-Fluorouracile;ac.fol: acide folinique; ffl 5/16: association de 5-FU et de OHP perfusée pendant 5 jours consécutifs suivis d'un intervalle libre de 16 jours; FFL 4/10: triple association perfusée pendant 4 jours consécutifs suivis d'un intervalle de 10 jours. RO: Réponses tumorales objectives
VARIATIONS DES PARAMETRES BIOLOGIQUES
HEMATOLOGIE:
-- Amplitude ( diff entre pic et creux)
_ GB 2400
_ PN 1800
_ Lc 1600
_ Plaq 54000
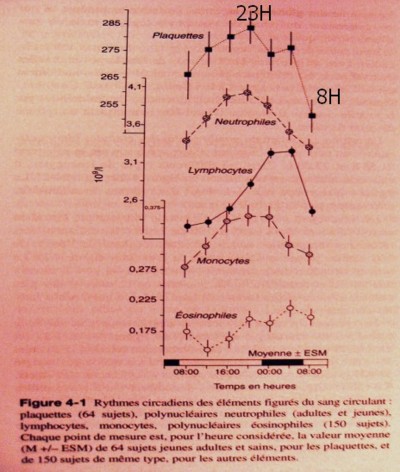
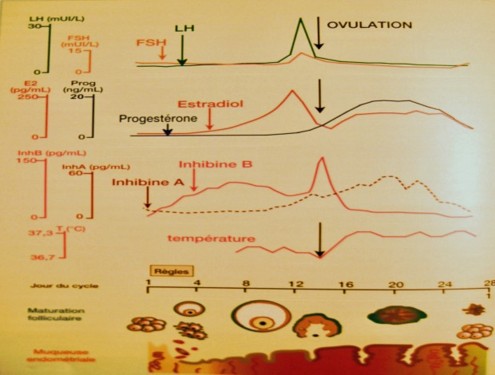
PROLACTINE: RYTHME NYCTHEMERAL
• LA PROLACTINE EST RYTHMEE PAR LE SOMMEIL : AUGMENTATION 1H30 APRES L’ENDORMISSEMENT, MAXIMUM ENTRE 4H ET 7H DU MATIN MAIS VARIATIONS INDIVIDUELLES
• IL EXISTE AUSSI UNE PULSATILITE ULTRADIENNE PROPRE A LA CELLULE : UNE CELLULE A PROLACTINE
ISOLEE GARDE SA PULSATILITE
PROLACTINE:
RYTHME NYCTHEMERAL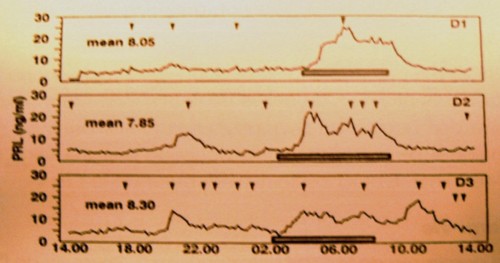
PROLACTINE: LA PULSATILITE, RYTHME ULTRADIEN
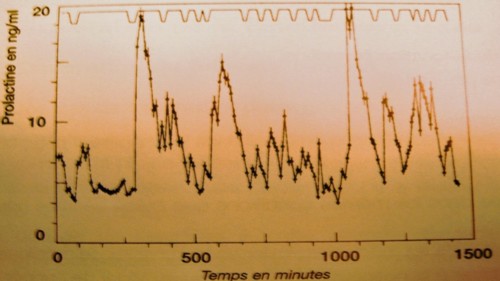
CONSEQUENCES PRATIQUES
PROLACTINE:
PRELEVEMENT LE MATIN AU MOINS DEUX HEURES APRES LE REVEIL, SUR UN POOL DE SERUM PRELEVE A 30 MINUTES D’INTERVALLE.
HORMONALE:
02, FSH, LH : J3-J5
PROGESTERONE:J20-J DE PREFERENCE A 8HOO LE MATIN
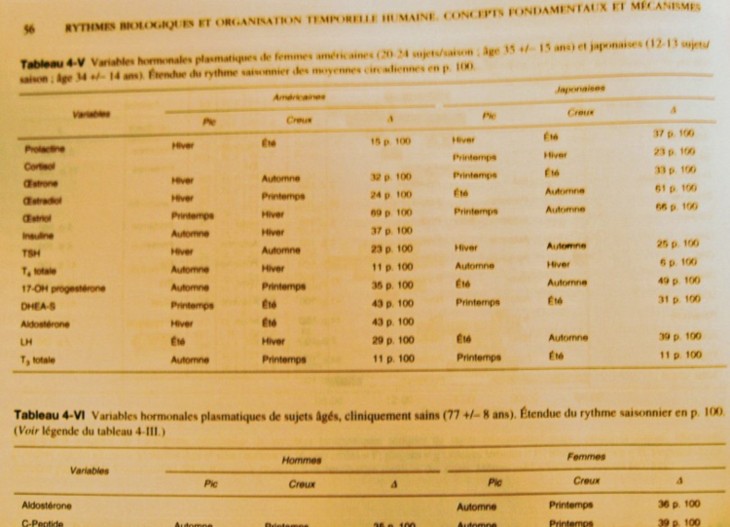
• CONCLUSION
• LA CHRONOBIOLOGIE PERMET DE MIEUX COMPRENDRE ET INTERPRETER LES RESULATS D’ANALYSES BIOLOGIQUES:
– DEUX RESULTATS NE PEUVENT ETRE COMPARES QUE S’ILS SONT PRELEVES AUX MEMES HEURES
• LA CHRONOTHERAPEUTIQUE PERMET:
– DE RESTAURER LES RYTHMES BIOLOGIQUES PERTURBES PAR LA MALADIE
– D’OPTIMISER LES EFFETS DES AGENTS THERAPEUTIQUES EN AUGMENTANT LEUR EFFICACITE ET/OU LEUR TOLERANCE
– LA CHRONOTHERAPIE PERMET A L’EXTREME DE PERSONNALISER LE TRAITEMENT ET DEFINIR LE QUAND ET LE COMMENT POUR CHAQUE CAS
RYTHMES SAISONNIERS CHEZ LES ANIMAUX
• LES MOUTONS SONT LES PLUS ETUDIES AU NIVEAU DE LA REPRODUCTION:
– BELIER: décembre à juin : production de 1 milliard de spermatozoïdes
<-> 5 milliards en septembre; de même pour testostérone
(de l’agressivité et de l’odeur ++)
– BREBIS: 2 périodes:
• Août – février: 100% des femelles ont une ovulation/mois
• Juillet août: faible %age d’ovulation
ÞGrossesse de 5 mois: pic de naissance en février mars
ÞLait de brebis: collecte le mois après accouchement
Production massive de fromage de brebis au printemps été:
• Ce rythme n’existe pas à toutes les latitudes: il n’y a pas de rythmicité dans les régions proches du Mexique (proche de l’équateur)
• C’est le raccourcissement des jours qui augmente l’activité sexuelle
Comment ce raccourcissement est-il perçu chez l’animal?
• EXPERIENCE MENEE A LA LUMIERE ARTIFICIELLE:
– UN GROUPE PASSE D’UNE DUREE D’ECLAIRAGE DE 16H A 13 H
– UN DEUXIEME GROUPE PASSE DE 10H D’ECLAIRAGE A 13H
àDANS LE PREMIER CAS, IL Y A STIMULATION DE L’ACTIVITE SEXUELLE DANS LE DEUXIEME IL Y A INHBITION
ð LA LUMIERE SERT DE SYNCHRONISEUR ET SON EFFET EST FONCTION DU PASSE PHOTOPERIODIQUE
• MECANISME:
– C’EST LA DUREE DE SECRETION DE MELATONINE QUI TRANSCRIT LES DIFFERENCES DE DUREE D’ECLAIREMENT.
– IL Y A INTERACTION ENTRE LA SECRETION DE MELATONINE DES PINEALOCYTES ET LES CORPS DES NEURONES A GnRH PAR L’INTERMEDIAIRE DU IIIe VENTRICULE
• [MELATONINE] 20 X SUPERIEURE DANS LE LCR QUE DANS LE SANG
• PRESENCE DE RECEPTEURS A MELATONINE SUR LA TIGE PITUITAIRE DE L’HYPOPHYSE
BIBLIOGRAPHIE
• « CHRONOBIOLOGIE MEDICALE, CHRONOTHERAPEUTIQUE » A.E.REINBERG ( Ed Flammarion)
« PATHOLOGIE BIOLOGIE » vol.44, n°6, juin 1996
« PATHOLOGIE BIOLOGIE » vol.44, n°7, septembre 1996